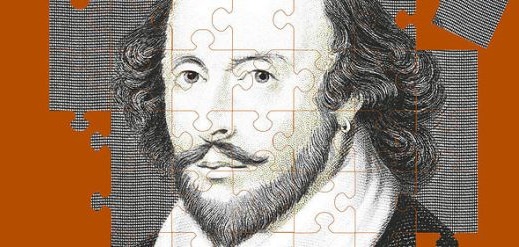Pharoah Sanders, l’un des sons de saxophone ténor les plus distinctifs de la Musique contemporaine, est décédé le 24 septembre 2022, à l’âge de 81 ans, à Los Angeles.
Sa mort a été annoncée dans un communiqué laconique par Luaka Bop, la société pour laquelle il venait de réaliser son dernier album, « Promises ».
Le son tiré de son saxophone ténor était une force de la nature : énorme, flamboyant, enveloppant, imprégné de blues profond, s’appuyant sur une technique hors normes pour créer des harmoniques hurlantes et des multiphoniques imposantes.

Avec ce son brutal et corrosif, Pharoah Sanders pouvait paraître féroce ou angoissé ; il pouvait aussi avoir l’air gentil et apaisant. C’est de par ce contraste que Sanders est et restera Le Pharaon, très apprécié par ses pairs, voire révéré, par un grand nombre d’amateurs de jazz.
Bien qu’il se soit fait un nom grâce au mouvement du Free jazz expressionniste, presque anarchique (agression nue, obsession aveuglante, passion effrénée..), en tant que membre des groupes de John Coltrane de 1965 à 1967, Pharoah Sanders a ensuite été guidé par des préoccupations moins agressive, plus gracieuses. Dans les années qui ont suivi la mort de John Coltrane, il a commencé à explorer d’autres voies, un peu plus calme et peut-être plus cérébrales – sans, il faut l’ajouter, sacrifier l’intensité acquise chez Coltrane.
Pharoah Sanders a poursuivi une carrière fertile et prolifique, avec des dizaines d’albums et six décennies de performances sur scène. Il a joué du Free Jazz, des standards de jazz, des airs optimistes teintés des Caraïbes et des incantations aux racines africaines et indiennes telles que « The Creator Has a Master Plan », qui a ouvert son album de 1969, « Karma », un summum du Free Jazz Dévotionnel. Il a beaucoup enregistré en tant que leader et collaborateur, travaillant avec Alice Coltrane, McCoy Tyner, Randy Weston, Joey DeFrancesco et bien d’autres.