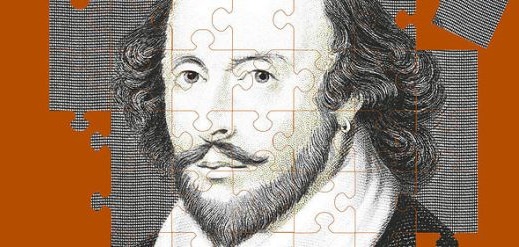En moins de vingt ans, le monde s’est liquéfié. Hommes, capitaux, marchandises, informations, idées et savoirs circulent désormais librement. Temps et distances sont abolis. Mais dans le monde idéal que nous avaient promis les chantres de l’auto-régulation et les disciples de l’école de la «main invisible» d’Adam Smith, ces avancées devaient entraîner la fin des inégalités par la valeur partagée, la paix entre les peuples et la disparition des Etats, formes obsolètes du pouvoir.
Constat d’échec collectif
Il n’en est évidemment rien. Pandémies, famines, déplacements de populations dus à la pauvreté ou aux conflits armés, bulles spéculatives, trafics de toutes natures, propagandes et fanatismes prolifèrent, tandis qu’émergent de nouvelles entités criminelles, aux fortes capacités financières, parfois appuyées sur des Etats-fantoches.
Simultanément, la compétition s’est exacerbée entre Etats, entre entreprises. Prix et spécificités des produits ou services ne constituent plus exclusivement les facteurs déterminants de conquête des marchés. Dans ce climat de guerre économique où tous les coups sont permis, de nombreuses entreprises sont restées ou devenues les meilleures mondiales dans leur secteur d’activité. Les ouvriers sont considérés parmi les plus qualifiés et les plus productifs; la recherche nationale jouit d’une grande réputation en dépit d’un cadre institutionnel et juridique archaïque.
Mais la compétitivité de notre pays a régressé. Autour de nous, plus des millions d’enfants et de jeunes de moins de dix-huit ans vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Qui peut accepter cela ? Pour le salarié, le cadre ou le chef d’entreprise, le fonctionnaire, ou chaque citoyen, c’est un échec collectif.
«L’Histoire ne repasse pas les plats»… Nous sommes aujourd’hui face aux choix qui décideront de notre existence comme communauté de destin : garderons-nous une part de liberté, de notre cohésion sociale et de notre capacité à proposer au monde notre langue, notre culture et nos valeurs, ou bien sommes-nous destinés à devenir un simple lieu mondial de villégiature ?
Quel visage aura notre pays dans dix ou vingt ans ? Que souhaitons-nous transmettre à nos enfants ?
Anticiper l’avenir
L’intelligence économique devrait aider à fournir une réponse à ces interrogations. Curieux avatar d’un concept devenu l’objet, dix ans après le rapport Martre qui lui avait assuré sa notoriété, d’efforts disparates et désordonnés, et parfois de ratiocinations d’intellectuels, de barbouzeries d’officines, ou de verbiages anglo-saxons de consultants…
Elle peut nous permettre d’anticiper l’avenir, de définir ce qu’il est essentiel de promouvoir et de préserver pour maîtriser notre destin, de transmettre aux générations futures un pays qui soit autre chose qu’un hypermarché au centre d’un champ de ruines sociales, abandonné par les théoriciens de «l’économie du savoir»; de guider le ciblage de nos efforts de recherche, de définir une politique dans laquelle, l’industrie, notamment, créatrice d’emplois, de richesses et de puissance retrouverait le rang de priorité nationale qu’elle avait ou aurait dû avoir.
L’expression d’intelligence économique n’est encore connue que d’initiés et reste singulièrement ambiguë : sans doute parce qu’elle est trop souvent comprise dans son acception anglo-saxonne alors même qu’elle ne couvre le plus souvent que des méthodes classiques et éprouvées de veille concurrentielle5. Voilà l’échec majeur des citoyens : s’être focalisés sur les moyens et avoir occulté les fins…
Alors dix ans pour rien ? Ce serait injuste à l’égard de cette petite communauté qui a accompli, dans un environnement dubitatif, d’incontestables efforts de sensibilisation, d’information, d’enseignement, voire d’acclimatation du concept dans la pratique de certaines grandes entreprises. La plupart des acteurs publics et privés reconnaissent avec contrition qu’à l’évidence l’intelligence économique n’occupe pas la place qu’elle mérite, c’est-à-dire celle qu’elle occupe en réalité dans les grands pays occidentaux.
Les faiblesses institutionnelles
Il eût fallu d’abord que l’Etat construise une doctrine : qu’il identifie les intérêts économiques et scientifiques majeurs de notre pays, puis qu’il mette en place les outils destinés à leur promotion et à leur défense.
Ce ne fut pas le cas. Il y eut des essais, il y a encore aujourd’hui quelques tentatives, mais à ce jour jamais synthétisés ou formalisés.
Il eût fallu ensuite que les administrations publiques soient conduites, voire contraintes, à collaborer entre elles, que l’information circule de manière horizontale et non exclusivement de manière verticale. Que les cloisons en somme disparaissent, et que s’atténuent les rivalités et les jeux de «corps».
Ce ne fut jamais le cas… Pas plus que n’ont été reconnues et favorisées les convergences d’intérêts entre le secteur public et le secteur privé. Or ces relations sont teintées de méfiance, ou de défiance depuis toujours : notre culture nationale, sans doute… Les pouvoirs publics s’arrogent le monopole de la défense de l’intérêt général; les entreprises dénoncent de leur côté l’incapacité de l’Etat à comprendre les réalités du marché et la psychologie de ses acteurs… Et méconnaissent ses atouts.
Bref, l’impulsion politique n’est jamais venue…
Des retards cumulés
A ces handicaps institutionnels s’ajoutent des handicaps culturels : nos élites, issues de la fonction publique ou de l’entreprise, n’ont été formées que superficiellement aux transformations de notre environnement économique international. La mondialisation s’inscrit certes dans leurs préoccupations ou parfois dans leurs ambitions personnelles; l’attractivité des MBA aux Etats-Unis est croissante pour nos étudiants comme celle de la Silicon Valley pour nos chercheurs, plus nombreux là-bas que tous les personnels du CNRS. Mais l’idée d’enrichir leur pays d’origine de ces formations ou des connaissances acquises outre-Atlantique est restée pour eux en quelque sorte accessoire.
La défiance -encore si répandue- de nos universités à l’égard du monde de l’entreprise, l’absence jusqu’à présent d’un statut fiscal et administratif attractif pour les fondations, ont retardé l’apparition de « think-tanks » à l’instar de ceux qui, en Allemagne, en Angleterre et surtout aux Etats-Unis, ont contribué à élaborer la «pensée moderne» et à enrichir tous les centres de décision publics et privés de leurs travaux.
Enfin on soulignera l’importance – c’est un euphémisme – des services de renseignement dans les pays anglo-saxons et aux Etats-Unis, où ils séduisent et retiennent les meilleurs de leurs jeunes étudiants et chercheurs. Des services de renseignement étroitement imbriqués, et sans pudeur aucune, avec les autres administrations publiques et les entreprises, en particulier celles qui ont pour métier de conseiller, d’auditer, d’assurer, d’investir et d’innover…
Nos faiblesses dans ces domaines sont tragiques : les marchés du conseil, de la certification et de la notation sont totalement dominés par les Américains et les Britanniques, ainsi que toutes les formes et tous les réseaux techniques d’information. Cette hégémonie s’étend aux fonds de pension mais aussi à de nouvelles formes d’influence mises en œuvre par des organisations non gouvernementales (ONG), des sociétés de lobbying, dont l’efficacité dans les instances internationales nous laissent désarmés… Partout où s’élaborent les règles, les normes, voire les modes, nous avons perdu pied. Des sociétés d’intérêt stratégique passent sous le contrôle d’investisseurs avisés ; des technologies étrangères sont retenues pour traiter des informations liées à notre souveraineté ou à la circulation d’informations confidentielles. Sur de nombreux marchés extérieurs, nos entreprises-phares sont soumises à des déstabilisations parfois inimaginables. Ce constat de carence et d’impuissance ou, dans le meilleur des cas, de désordre, est partagé par la quasi-totalité des acteurs publics et privés.
Disons-le franchement : nous ne cultivons pas le réalisme de nos principaux concurrents pour lesquels il est aussi naturel qu’une respiration de défendre toutes les formes de souveraineté et de progrès de leurs pays. Un réalisme qui aurait dû nous conduire à passer de la fascination à l’imitation, ou du voyeurisme à l’action…
Economie de partage
L’intelligence économique devrait être une vraie et grande politique publique de l’Etat à l’instar de ce que sont les politiques de santé, d’environnement ou de fiscalité.
L’intelligence économique peut nous aider -Etat, entreprises, collectivités territoriales, associations et fondations- à promouvoir collectivement nos intérêts dans les nouvelles enceintes de régulation et de normalisation.
L’intelligence économique ne coûte rien, ou pour ainsi dire, pas grand-chose : son efficacité repose sur celle des réseaux, des circuits de l’information, sur la mobilisation des pouvoirs publics, l’élimination des conflits de chapelle et des cloisonnements, sur un peu de méthode. Sur la valorisation aussi de celui qui donne l’information et non de celui qui la retient, sur la compréhension par les administrations publiques des enjeux de l’entreprise et, pour l’entreprise, des priorités de l’Etat et donc de la Nation.
De l’intelligence économique nous pouvons attendre la protection de notre patrimoine scientifique et industriel, des gains de compétitivité et des parts de marché, une influence renouvelée dans le monde auprès notamment de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à dépendre d’un fournisseur exclusif, mais aussi, dans les organisations internationales, auprès de ceux qui pourraient se désoler du contournement ou du refus des règles du droit international : hier celles de Kyoto, aujourd’hui celles de l’ONU, et demain, plus qu’hier peut-être, celles de l’OMC.
Politique sociale
Sans paranoïa ni panique, il est temps de réagir et, tout simplement, de réaliser « trois mariages et un enterrement » : le mariage entre les administrations publiques, le mariage entre le public et le privé et le mariage de l’information blanche avec celle qui l’est un petit peu moins… L’enterrement alors, sera, celui des naïvetés françaises !
Que cette politique soit nationale, décentralisée ou internationale, elle ne pourra s’épargner un effort de formation et d’information calibré à cette ambition et adapté à une certitude : l’intelligence économique est un patriotisme économique. Je devine le sourire du lecteur à la découverte de ces mots. Que notre tropisme soit notre région, notre pays ou le monde, c’est pourtant ce patriotisme économique qui sera le garant de notre cohésion sociale. S’il n’en est convaincu par sa réflexion propre, qu’il examine, sans parti-pris, comment nos grands partenaires se comportent et réussissent.
Le patriotisme économique n’est pas une idéologie, pas plus que l’intelligence économique n’est un concept : c’est une politique sociale.
Bernard CARAYON
Notis©2012