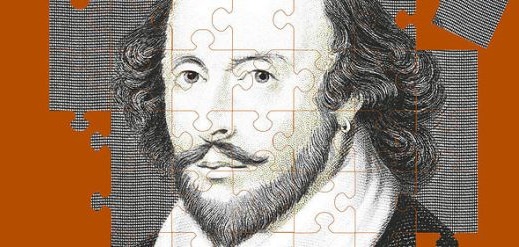Au-delà des quelques cas qui défrayent de temps à autres la chronique, comme ces deux Sud-Africains arrêtés alors qu’ils tentaient de monter une fraude à l’assurance-vie avec une vraie-fausse morte, la fraude à l’assurance reste mal connue du grand public. Sans doute parce qu’il est très difficile de chiffrer exactement ce fléau et que les assureurs sont réticents à communiquer sur le sujet. Reste que le phénomène est massif à en juger par un rapport, diligenté par les compagnies d’assurances, selon lequel les cas frauduleux, qu’ils soient détectés ou non, représenteraient près de 10 % de la charge totale de sinistres. Par ailleurs, un sondage d’opinion fait ressortir qu’une personne interrogée sur quatre connaît quelqu’un ayant déjà une fois fraudé l’assurance.
Des pertes colossales…
En Grande-Bretagne, par exemple, les assureurs ont mis à jour en 2011 plus de 138.000 sinistres frauduleux pour un coût total de 983 millions de livres (1,15 milliards d’euros), soit 5 % de plus que l’année précédente. Mais il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg, puisque la fraude non détectée s’élèverait, elle, à 1,9 milliard de livres.
En France, on constate aussi une augmentation du phénomène -qui serait, de l’avis général, encore plus vivace en période de crise économique, avec son lot de déclarations de sinistres manifestement exagérées ou d’incendies suspects. D’après les données de l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (Alfa), les assureurs-dommages ont ainsi recensé plus de 35.000 sinistres frauduleux en 2011, soit presque trois fois plus qu’en 2003, pour un montant total de 168 millions d’euros (contre 47 millions huit ans plus tôt). Quant au coût réel de la fraude, il est estimé à 2,5 milliards d’euros (« Les Echos » du 24 octobre 2012). En Suède, les cas décelés ont atteint 40 millions d’euros en 2011. Tout aussi édifiant, dans un sondage réalisé en 2012, 27 % des Finlandais disaient connaître une personne « qui a trompé sa compagnie d’assurance », contre 25 % en 2011…
…supportées par des « honnêtes consommateurs ».
Comme ne manque pas de le souligner les compagnies d’assurances, ce phénomène massif a évidemment un coût puisqu’il est répercuté dans les primes d’assurance. Autrement dit, ce sont les « honnêtes consommateurs » qui payent la facture au final. D’après l’association des assureurs britanniques (ABI), la seule à donner un tel chiffre, la fraude entraînerait ainsi en moyenne un surcoût de 50 livres par assuré et par an !
« Ce n’est pas un crime insignifiant », insiste Insurance Europe, en évoquant des études qui « suggèrent qu’elle finance et facilite d’autres activités criminelles sérieuses ». Les assureurs ont donc pris le problème à bras-le-corps, avec des approches et des moyens très variés d’un pays à l’autre. Ici, comme en Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas, par exemple, ils échangent des informations entre eux. Là, comme en France, en Suède ou au Royaume-Uni, des agences sont en charge de mener des investigations sur la fraude. Ce sont surtout les assurances des véhicules automobiles, de l’inventaire du ménage, des objets de valeur et de voyage qui font l’objet d’escroqueries. Ces dernières années, le nombre des tentatives d’escroquerie détectées a augmenté, ce qui peut être notamment dû au fait que les compagnies d’assurances examinent les cas de sinistres annoncés de plus près qu’auparavant.
Les moyens anti-fraude des compagnies d’assurance
Les compagnies d’assurances ne suspectent naturellement pas chaque déclaration de sinistre d’être une tentative de fraude. Mais si certains indices donnent à penser que les prétentions ne sont pas fondées, le cas est examiné de plus près. A cet effet, nombre de compagnies disposent de véritables spécialistes qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Grâce à l’expérience acquise, ces spécialistes possèdent les connaissances voulues pour procéder à l’examen précis des faits. Ils ont ainsi à leur disposition des instruments permettant de voir si un document a été falsifié.
Les compagnies d’assurance se regroupent en associations. Ces associations sont un moyen d’échange d’informations et d’expériences entre les compagnies. Elles sont aussi en relation avec les autorités de la police et des douanes ainsi qu’avec plusieurs services spécialisés en matière de fraude internationale. Cet instinct de regroupement de front anti-fraude facilite la systématisation des réseaux de prestataires agréés d’assurance (réparateur auto, opticien ou dentiste agréé, ..), car elle permet d’encadrer les pratiques. Les prestataires agréés, en échange du respect d’un cadre de pratiques de gestion, sont assurés d’un chiffre d’affaires. De plus, ceux-ci sont régulièrement audités et testés par des organismes externes.
Par des communications régulières dans la presse écrite et les médias électroniques, une Associations, comme Insurance Europ, veut montrer aux assurés que tout sinistre n’est pas indemnisé tel quel et que les primes versées par les assurés honnêtes sont gérées dans un esprit d’économie.
Notis©2013